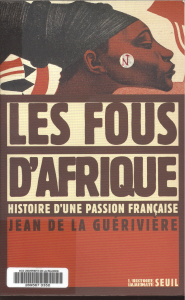L'école coloniale
Il faut lever l'ambiguïté de ce titre. Par « école coloniale »
, on entend parfois l'école, d'enseignement primaire ou secondaire, développée dans les colonies, essentiellement à destination des populations indigènes.
On se souvient des fameux dessins de Hergé, montrant Tintin (au Congo) enseignant à de petits Africains, ou à ces nombreuses photographies, parfois à usage de propagande, de classes indigènes, attentives à l'enseignement d'un instituteur, généralement lui-même indigène. Ou encore de l'école des otages, fondée par Gallieni lors de sa campagne du Soudan. |
Par école coloniale, j'entendrai avant tout la «Colo», créée en 1895, et qui deviendra l'Ecole Nationale de la France d'outre-mer en 1934. Mais cette école, si elle est la plus célèbre, ne résume pas à elle seule la totalité des enseignements supérieurs coloniaux dispensés sous la troisième République (voir Singaravélou[2]).
Enfin, la finalité de cette école et de ces enseignements est une question déterminante. Ils sont d'abord des moyens de diffusion des savoirs sur les territoires occupés par la France : ethnologie, géographie, agriculture, botanique, géologie, langues, etc. Dans ce sens ils s'inscrivent en droite ligne dans la tradition des découvertes et des explorations des voyageurs comme Bernardin de Saint-Pierre ou Bory de Saint-Vincent, ainsi que des travaux des missionnaires. Ils n'ont qu'indirectement partie liée avec le fait colonial.
Ensuite, certains enseignements, et particulièrement la formation dispensée à l'école coloniale proprement dite, aura pour but de former des administrateurs coloniaux, ainsi que des magistrats coloniaux. Or, un bon administrateur serait celui qui a une sérieuse connaissance du terrain, et en particulier des indigènes, de leurs mœurs, voire de leur langue.
Enfin, à propos de ces mêmes indigènes, il importe de connaître la place qui leur est faite, tant dans l'enseignement supérieur colonial en général, que dans les écoles et instituts de formation à la gestion et à l'administration, puis, dans l'enseignement supérieur métropolitain.
Que le rôle de l'enseignement supérieur colonial soit un élément, parmi les plus intelligents cela va sans dire, de la propagande, c'est ce que nous démontrent les premières lignes d'un article d'Edmond Gain, paru dans la Quinzaine coloniale en 1902 sur les Universités et l'enseignement colonial :
Le monde colonial, et la presse coloniale elle-même, voient avec intérêt la création de ces tribunes permanentes d'où vont tomber chaque jour des encouragements à l'émigration raisonnée et judicieuse de nos capitaux et de nos jeunes énergies.
Ces centres d'études deviendront naturenement des guides éclairés, désintéressés, de bienveillants offices de renseignement qui seront visités par les vocations naissantes ayant besoin de se fortifier et d'être dirigées. Pour jouer ce rôle de tuteur, il faut des organisations stables, ayant une haute autorité morale, échappant au soupçon de parler par passion ou par intérêt : les Universités peuvent remplir ce rôle ( p. 718[3]).
Le rôle de l'Université serait donc d'assumer, dans un dosage subtil, d'une part un rôle de recrutement colonial, en "encourageant" les jeunes vocations, et d'assurer ainsi à l'avenir une bonne gouvernance des colonies, ainsi que les moyens de faire aller les capitaux dans les possessions d'outre-mer (les écoles de commerce ne sont en effet pas les dernières à mettre en place des enseignements coloniaux) — et d'autre part une garantie de scientificité, d'objectivité et de prestige que seuls ces établissements peuvent fournir.
Dans les facultés des Sciences de Paris, Nancy, Montpellier, on offre dès le début du XXe siècle des spécialisations en géologie, botanique, foresterie et médecine coloniale ( Singaravélou, p. 76 et suiv.[2]). On n'oublie pas la missiologie dans les établissements catholiques ou de théologie protestante. A Saint-Cyr et à Polytechnique, on enseigne la géographie militaire.
Liés à la propagande, ces enseignements ne sont cependant pas réduits au rôle de vecteur colonialiste, dans la mesure où ils ont effectivement produit du savoir, dans tous les domaines, et ont fait avancer les connaissances, tant en ethnologie, qu'en géographie et dans le domaine des sciences en général :
Il est impossible de réduire purement et simplement l'enseignement supérieur colonial à sa dimension propagandiste : il a pu être aussi un lieu de production de nouveaux domaines scientifiques, telles la géographie de l'aménagement de Marcel Dubois, l'anthropologie juridique de René Maunier ou encore l'ethnobotanique d'Auguste Chevalier ( Singaravélou, p. 81[2]).
Quant aux établissements de formation coloniale proprement dits, il s'en crée à Lyon, (1899), au Havre (1908), et dans les colonies elles-mêmes : à Alger (l'Université regroupant sciences, lettres et médecine est créée en 1909), à Hanoi (1907, mais fermée entre 1908 et 1917), plus tardivement à Tunis et à Dakar. |
L'école coloniale de Paris
Mais l'institution la plus prestigieuse reste l'École coloniale de Paris.
C'est d'abord Auguste Pavie, qui après avoir développé les lignes de télégraphe au Cambodge, vient à Paris avec treize Cambodgiens pour y recevoir une formation destinée à faire d'eux des collaborateurs. Ainsi est créée l'École cambodgienne en 1885.
Par un arrêté du 11 janvier 1888, cette école est transformée en École coloniale, et est ouverte aux ressortissants des colonies françaises. Sous l'impulsion de Paul Dislière, nommé directeur en 1892, l'école va se développer et obtenir, en 1912, le monopole de la formation des administrateurs coloniaux. Georges Hardy, historien, et ancien directeur de l'enseignement en AOF, prend la direction de 1926 à 1933. Ses réformes vont aboutir à la création de classes préparatoires dans les grands lycées parisiens, ainsi qu'en province. L'enseignement devient gratuit, en échange d'un engagement de cinq ans dans l'administration coloniale. |
L'école change de nom en 1934 et devient l'Ecole nationale de la France d'Outre-Mer (ENFOM). Robert Delavignette en sera le directeur de 1937 à 1946 : sous sa direction, « les cours furent plus généralistes : économie, droit, géographie, langues, ethnologie, médecine et hygiène tropicale, culture autochtone. Des enseignants renommés y donnaient des cours : Jacques Soustelle, Henri Maspéro, Charles-André Julien, Henri Brunschwig, Léopold Sédar Senghor. L'ouverture de l'école nationale d'Administration et les prémices de la décolonisation sonnèrent le glas de l' école nationale de la France d'Outre-Mer. Elle fut remplacée en 1959 par l'institut des Hautes Etudes d'Outre-Mer chargé de former les cadres administratifs des pays de la communauté. En 1966, l'institut international d'Administration publique, chargé d'assister les pays ayant accédé à l'indépendance dans la formation de leurs propres administrateurs lui succéda. »
(
Catalogue du CAOM[5])
Dans Les Vrais Chefs de l'Empire[6], paru en 1939, Robert Delavignette expose la charge qui lui revient, et sa profession de foi quant au rôle de l'administrateur colonial :
Administrateur des colonies depuis une vingtaine d“années, je me sens affermi dans mon état tout en éprouvant une difficulté croissante à le définir. Et maintenant que j'ai charge de l'apprendre à mes jeunes camarades de l'École Coloniale, il me semble plus informulable qu'au temps où je le pratiquais. Il m'interrogeait déjà dans les résidences africaines, mais alors il me suffisait de le vivre sans avoir à m'en expliquer. Aujourd'hui il m'attend à Paris entre les murs d'une classe et pour ne pas me laisser échapper : Ici tu dois répondre, ici, tu dois savoir. Mais plus j'y réfléchis, moins je crois qu'il puisse être énoncé dans tous ses attributs qui sont nombreux et qui varient en importance avec les lieux et les temps.
Dans telle contrée, l'administrateur sera comme l'intendant d'un domaine ; dans telle autre, il agira presque uniquement en conseiller politique et en médiateur et dans celle-là, où sa fonction paraissait avoir pris un caractère définitif, on le verra quelques années après se transformer en peseur-juré des produits d“exportation et en recruteur de main-d'œuvre pour des offices étatisés. Et je dis aux futurs administrateurs coloniaux qu'ils devront découvrir eux-mêmes le sens de leur colonie et le propre de son administration.
L'avouerai-je? Ces mots de colonie et d'administration ne rendent pas un compte exact de l'état d'administrateur colonial. Je murmure aux jeunes gens de l'École qu'ils s'engagent dans un monde nouveau qui est autre chose qu'une colonie et dans un art qui, loin d'ébaucher sous le tropique notre bureaucratie européenne, apporte au contraire un principe de renouvellement à toute administration, en Europe aussi bien qu'ailleurs. Puissé-je, en les formant, montrer ce monde nouveau dont j'ai conscience et fixer le goût de l'art que j'ai servi (p. 9-10).
C'est bien ce qui caractérise Delavignette que cette méfiance à l'égard des théories inadaptables au terrain, cette importance qu'il accorde à l'expérience, à l'intuition, à la connaissance empirique des réalités coloniales, au contact et à la compréhension de ce qu'il appelle l'"esprit africain". Il vit donc son rôle de formateur comme une activité paradoxale, à travers laquelle cependant il souhaite transmettre des valeurs humanistes. L'adaptation de chacun à chaque cas particulier dans un univers colonial extrêmement divers peut être facilitée par l'enseignement.
Ce qui caractérise aussi cette introduction de Delavignette, c'est l'idée que l'administration coloniale n'est pas sans lendemain au-delà même de la colonisation, car elle préside à la formation de ce qu'il appelle un "monde nouveau". L'Afrique, qui est son terrain de prédilection, bascule à son rythme et à sa manière dans ce monde. A sa manière, car Delavignette corrige l'effet d'optique d'un progrès encore très marqué par l'évolutionnisme historique de son temps : il ne s'agit pas pour l'Africain de parcourir en courant le chemin emprunté par les Européens depuis un millénaire, mais bien d'assumer son propre parcours. Et c'est également l'Europe qui se transforme à travers ses entreprises et sa gestion du monde colonial qu'elle a créé. Sur cette question particulière de la formation des administrateurs, c'est bien l'ENFOM[7] qui précède et d'une certaine manière prépare l'ENA[8], non l'inverse.
L'Ecole coloniale et l'ENFOM auront suscité et consolidé bien des vocations (voir Jean de La Guérivière[10], p.88-116), dont de nombreux témoignages et mémoires portent la trace. D'une certaine manière, ces écoles, légitimisent l'aristocratie des chefs, des maîtres et des "rois broussards" qui va peu à peu succéder à des administrateurs mal préparés et qui va remplacer, et souvent contrecarrer, celle des colons dont parlait Tocqueville. |
Complément : Les projets de Robert Delavignette
Du côté français, l'institutionnalisation d'une science de l'administration coloniale sera circonscrite à l'École coloniale, école professionnelle assez éloignée des centres intellectuels et scientifiques que sont les universités parisiennes. Elle s'incarnera principalement dans un cours de “méthodes coloniales françaises et étrangères” créé en 1926 et assumé à partir de 1937 par Henri Labouret et Robert Delavignette, puis à partir de 1946 dans un cours de politique indigène qui sera, deux ans plus tard, confié à ce dernier.
Suite d'ailleurs aux réformes entreprises alors qu'il était directeur de l'École coloniale (1937-1946) et reprises par ses successeurs, elle finira par faire l'objet d'une chaire créée en 1951 et intitulée “Droits et coutumes d'outre-mer” (94), chaire réservée à Robert Delavignette lui-même. A bien des égards, une telle institutionnalisation représentera pourtant une bien maigre consolation comparée aux réformes d'ampleur qu'envisageait ce dernier, réformes grâce auxquelles il entendait faire de l'École coloniale un centre de recherche spécialisé dans l'administration coloniale" (Véronique Dimier, p. 9[11])
L'ENFOM par Abdou Diouf
Abdou Diouf évoque l'ENFOM[7]. INA[12], "Grands Entretiens", http://www.ina.fr/grands-entretiens/video/Afriques