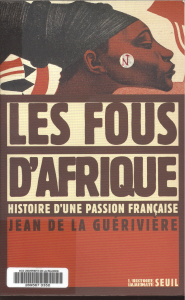La vocation coloniale
Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici ?
À la question que l'on pose au voyageur André Gide sur le navire qui l'emmène au Congo, « Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas ? »
, fait écho la question du colonial fraîchement débarqué de son nouveau territoire :
« Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? »
.
C'est en effet la question qui se pose éternellement et à laquelle, au cours des siècles, d'innombrables réponses ont été apportées.
La vocation proprement dite n'est pas toujours à l'origine de l'exil plus ou moins volontaire du candidat à l'installation coloniale. S'il s'agit d'un « civil », et qu'il se range dans la catégorie de ceux qu'une histoire d'amour malheureuse, ou plus prosaïquement une faillite déguisée, des dettes impossibles à rembourser, ont fait chercher dans les colonies une porte de sortie, il est clair qu'on chercherait vainement à l'origine de leur décision les traces d'un militantisme courageux ou d'un héritage spirituel. Quand il ne s'agit pas d'un mélange de motivations honorables ou non, dont les fils psychologiques s'entremêlent :
Savait-on ce qui l'avait attiré sur la terre d'Afrique ? Patriotisme ? Goût de l'aventure ? Ambition ? Intérêt ? De tout un peu, les calculs mêlés aux chimères... ( Sous le casque blanc, p. 69[1])
Pour cette catégorie de coloniaux, qui a servi de modèle à de nombreux romans, les issues sont diverses : ils peuvent effectivement et malgré tout prendre goût au monde colonial, s'y établir, et recommencer une vie plus heureuse. Au contraire, ils peuvent être amenés à déchoir davantage, à devenir une épave pour se référer au titre de l'ouvrage de Jean d'Esme, Épaves australes[2]. Toutes les combinaisons intermédiaires sont bien entendu possibles.
Exemple : Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici ?
Le Chef des porte-plumes[3], de Robert Randau. Ce titre, on s'en doute, désigne ironiquement la fonction du Gouverneur colonial entouré de ses fonctionnaires, métier que Robert Randau (1873-1950), de son vrai nom Robert Arnaud, connaissait bien pour l'avoir exercée lui-même en Algérie (il est l'un des fondateurs de l'algérianisme). L'action se passe ici dans une colonie qu'on reconnaît être le Sénégal. Et chacun d'étaler les motivations qui l'ont conduit à entamer une vie coloniale : « Assez de blagues ! Pas de boniments de gouverneur ! On vient ici pour gagner de l'argent ou des galons, rien de plus »
(p. 104).
« Eh bien, mes amis, il est maintenant des heures où je me demande ce que nous sommes venus faire ici, aux dépens de notre vie ; nous avons eu des gestes héroïques, mais à quelles fins ? Jamais notre race ne s'acclimatera dans les pays tropicaux, où elle ne peut que s'atrophier en se métissant »
(p. 240-241)
Exemple : Qu'allait-il faire dans ces terres désolées ?
Robert de Coussan (dans la
Maîtresse noire[4] (1928) de Louis-Charles Royer) protégé par un ami, quitte Paris pour le Soudan, alors qu'il est couvert de dettes, et entre dans l'administration coloniale. Il découvre les amours noires, et en particulier une maîtresse qui le ruinera et s'enfuira avec un cinéaste parisien. Mais avant de partir, il aura hésité longtemps : « Qu'allait-il faire dans ces terres désolées, au milieu de coloniaux alcooliques, avec les compagnes promises par Bourdier, les lourdes négresses qui sentent le beurre rance et le poisson séché ? Une fois encore, il pensa : il ne faut pas partir »
(p. 306).
Les "fous d'Afrique"
La vocation coloniale est née tardivement.
A l'opposé des explorateurs et des militaires, et encore de ceux d'un rang des plus élevés, la plupart des recrues de l'administration coloniale ne sont là que pour des motifs qui n'ont pas grand chose à voir avec la passion.
Cependant, cette passion existe, et elle se déclarera d'autant plus aisément que la politique française, en attachant de plus en plus d'importance au monde colonial, c'est-à-dire en lui attribuant une place plus honorable au sein du gouvernement que celle d'une simple direction — la création d'un ministère des colonies constitue évidemment l'apogée de cette considération tardive — en accordant enfin à la formation des administrateurs coloniaux une véritable consécration lors de la fondation de l'Ecole coloniale.
Il est d'ailleurs paradoxal ou ironique de constater que la vocation coloniale ne va prendre tant d'ampleur et se répandre parmi les élites qu'au moment où s'approche le terme mis par l'histoire à l'entreprise coloniale.
Nés au lendemain de la première guerre mondiale, les futurs élèves administrateurs rencontrés croisent sous diverses formes et à diverses reprises durant leur enfance mais surtout leur adolescence l'idée coloniale qui est à son apogée au cours des années trente (parents proches résidents ou ayant résidé outre-mer, visite de l'exposition coloniale de Vincennes en 1931, lecture de livres d'aventure circulant au sein du lycée, actualité cinématographique). C'est le moment où l'opinion française est enfin acquise au projet colonial, après une grande période d'hésitations et de remises en cause. On peut ainsi considérer les professionnels rencontrés comme les enfants du rêve impérial français de l'entre-deux-guerres, vaste surface de projections et d'aspirations diverses (de la figure du cavalier méhariste en charge de la pacification du Sahara au modèle de l'administrateur en charge de la bonification des terres africaines). La défaite et l'Occupation marquent les professionnels rencontrés. C'est à la fois l' « humiliation de la France » dans « une défaite en quarante jours », le « drapeau allemand partout dans Paris », mais aussi l'« ennui » d'une société métropolitaine repliée sur elle-même. La métropole des années 40 est en effet décrite à diverses reprises dans les entretiens comme “ ringarde ”, “ sans couleur franche ”, “ routinière ”, fait de “ gens jouant petit ” dans un “ environnement paralysant ”. La défaite est ainsi vécue d'autant plus douloureusement par cette tranche d'âge que les aspirations sont grandes à la sortie du baccalauréat, se trouvant privée d'un avenir glorieux (Jean-Charles Fredenucci[5]).
Complément : Témoignages
Voici deux témoignage cités par Jean-Charles Fredenucci[5], dans son enquête sur les anciens administrateurs de la France d'outre-mer :
« A l'automne 40, je suis rentré au lycée Henri IV [...] J'étais littéralement avide d'action. J'ai été reçu en 1943 au Concours. Et ce qui me tentait c'était de servir en zone saharienne, pré-saharienne. Tout un état d'esprit militaire sans doute : le père De Foucault qui n'était pas à la fin de sa vie militaire, Foureau, le désert. J'ai fait ma scolarité en 43-44. Je suis parti un moment au « maquis ». A l'automne 44, je me suis engagé comme volontaire dans la guerre en Extrême-Orient. J'ai fait avec plusieurs autres dizaines d'autres élèves de l'école un peloton d'élèves aspirants à Mont de Marsan. Et au moment de partir en Indochine, comme j'étais de la section africaine, l'école m'a récupéré pour faire ce que l'on appelait la relève des administrateurs qui avaient été bloqués par la guerre, qui étaient fatigués, qui étaient malades, qui devaient rentrer. [...] C'était la relève. C'était pas obligé mais ils (les élèves de l'ENFOM) pouvaient. C'était l'action qui me tentait et j'en ai profité...[...] »
« Partir Outre-mer pour prendre un poste comme on disait « de commandement », c'était échapper à l'occupation. Se retrouver avec un drapeau français sur la tête. Ça compte. Je n'ai pas honte de le dire. Un drapeau pour moi c'était important. Pour moi, être le représentant de la France comme on disait alors « à l'ombre de son drapeau ». J'hésite pas à le dire
. »
« Au vrai, nous étouffons dans nos cités étroites et bruyantes, notre âme s'y débat tristement, use ses ailes à tous les angles comme un oiseau prisonnier : or nous savons qu'il y a là-bas, au-delà de la mer bleue, un pays sans limites, où le soleil se déploie magnifiquement, où les âges du monde se confondent dans une atmosphère d'infini, où le danger ni la souffrance ne comptent pour beaucoup, parce que le rêve les absorbe, et notre cœur bondit vers cette liberté. »
Cette expression de " fous d'Afrique[7]" a été prise comme titre d'un ouvrage de Jean de la Guérivière, journaliste au Monde, pour désigner les passionnés du continent africain et des colonies en général. L'ouvrage s'inscrit dans la lignée des livres consacrés aux explorateurs et aux militaires ayant fondé l'empire, comme Sous le casque blanc[1], de Roland Dorgelès, qui présentait déjà sous forme de chapitres, des carrières d'explorateurs, de militaires et d'aventuriers (Brazza, Gallieni, Marchand, Joffre ...), ainsi que sur les travaux de Fredenucci et la solide documentation fournie par l'excellente thèse de William Cohen[8] — et bien sûr sur une longue expérience africaine personnelle. Publié en 2001, en pleine période de |