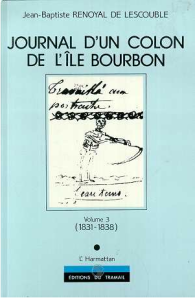Débats sur l'esclavage : avant l'abolition
La littérature anti-esclavagiste
La littérature anti-esclavagiste est une ancienne tradition occidentale. C'est sans doute au siècle des Lumières qu'elle se développe le plus nettement, entre autres et surtout à travers les encyclopédistes.
Comme le remarque Michel Herland (p. 41)[2], il n'y a pas grand chose de nouveau apporté dans le débat sur l'esclavage entre le XVIIIe siècle et le XIXe. Les arguments qui reviennent en effet, relancés d'un côté et de l'autre sont à peu près les mêmes : d'un côté le refus d'une pratique contraire au droit naturel, de l'autre la spécificité de la situation coloniale, particulièrement dans les îles, exigeant l'emploi d'une main d'œuvre servile. |
Cependant, des changements de perspective importants s'opèrent : la virulence du combat contre l'esclavage qui a aiguisé la plume la plupart du temps talentueuse des philosophes n'est plus tout à fait de mise, dès lors que l'abolition de l'esclavage, après l'interdiction de la traite, (1817) et a fortiori après l'abolition par les Anglais en 1833, paraît inéluctable à court ou moyen terme. En 1838, Tocqueville le dit clairement : ce dont on doit discuter à la Chambre des députés, ce n'est pas du maintien ou de l'abolition de l'esclavage, la question est réglée : c'est seulement de la manière dont les choses vont se passer : La Commission n'a pas non plus à établir que la servitude peut et doit avoir un jour un terme. C'est aujourd'hui une vérité universellement reconnue, et que ne nient point les possesseurs d'esclaves eux-mêmes ( p. 2[3]) [3]. De plus, le débat va se déplacer sur le terrain économique, en particulier après les analyses d'Adam Smith, voire de Turgot.
A la fin du siècle, dans les années 1880, le débat sur l'esclavage, occulté par son abolition en 1848 va se trouver relancé, mais avec cette fois d'autres acteurs, puisque l'abolition de l'esclavage, dans les pays africains cette fois, va constituer l'un des objectifs des conquêtes coloniales et une justification de l'expansion. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité confronter les discours coloniaux de ces deux périodes : avant et après l'abolition.
Il reste une autre constante que les historiens n'ont pas toujours suffisamment soulignée. C'est la position des antiesclavagistes et des esclavagistes sur le plan socio-économique. Au cours des débats d'avant 1848, les premiers rassemblent les colons, ainsi que les acteurs et bénéficiaires de la situation coloniale, qu'ils soient ou non directement impliqués dans la traite : les marchands, les armateurs, les hommes d'affaires et leurs représentants à la Chambre. Les seconds appartiennent généralement à la classe de ceux qu'on appellera plus tard les « intellectuels », ainsi que des politiques intéressés avant tout à la situation métropolitaine dans son ensemble. On reconnaît là la fracture entre les colons (et ceux qui travaillent avec eux) d'une part, et les métropolitains de l'autre. Lorsque Tocqueville constate qu'une nouvelle aristocratie s'est développée dans les colonies, qui s'appuie en outre sur des critères de couleur de peau, et que, comme toute aristocratie, elle défendra jusqu'au bout ses privilèges – affinant par là même l'idée d'Adam Smith selon laquelle les colons maintiennent un système peu rentable par « orgueil » — il montre bien que seule une intervention de la métropole, une révolution par le haut, peut mettre fin à la pratique esclavagiste (voir Steiner[4]).
La question de l'esclavage avant l'abolition
Voyageur et doctrinaire, Bernardin de Saint-Pierre[5] fustige avec élan les pratiques esclavagistes dont il se fait le témoin à l'île de France (île Maurice), se livrant de toute évidence davantage à la reproduction d'une imagerie antiesclavagiste largement répandue en Europe qu'à une observation objective.
Là, les maîtres, les colons, se montreraient d'une férocité sans égale, frappant leurs esclaves dès le matin, simplement pour les réveiller et les rappeler à leur triste condition. Les coups pleuvent d'ailleurs à longueur de journée, les travaux auxquels les malheureux sont soumis sont au-dessus de leurs forces. Lorsqu'ils sont devenus vieux, les maîtres les abandonnent à un sort misérable [7]. |
Ces assertions seront réfutées de manière tout à fait antinomique, ou tenteront d'être réfutées, par les colons. Ainsi, Thomi Pitot[7], colon de l'île Maurice, dans une conférence prononcée en 1805 (conférence publiée seulement en 1885) reprend point par point le récit de Bernardin pour en démontrer la fausseté, tout en regrettant que l'illustre écrivain dispose d'une audience infiniment plus considérable que les colons, — thème qui va traverser toute la littérature coloniale opposant le colon et le voyageur. A beau mentir qui vient de loin, et surtout, l'éloignement étouffe les voix de ceux qui seraient le mieux à même de s'expliquer.
Tous les voyageurs ne cautionnent pas cependant pas le témoignage de Bernardin. Ainsi, Auguste Billiard, écrivain, voyageur et haut fonctionnaire de la seconde Restauration :
Il n'est pas besoin de réfuter les homélies de Bernardin de Saint-Pierre sur les mauvais traitements que les blancs font éprouver aux noirs dans les colonies des îles de France et de Bourbon ; on ne commence pas la journée par des distributions de coups de fouet ; on ne frappe point ses esclaves pour une porcelaine cassée, ou pour une porte laissée ouverte ; les vieillards ne sont point abandonnés : il y a des traits de barbarie comme on en voit dans le reste du monde ; mais il ne fallait pas faire un éloquent mensonge pour charger une colonie entière de ce qui n'appartenait qu'à quelques particuliers ( p. 121[8]).
Il ajoute, et c'est là aussi une observation que l'on rencontre chez plusieurs voyageurs, que le sort des esclaves, du point de vue juridique, reste plutôt enviable par rapport à celui du petit peuple de métropole. La rigueur des lois à l'encontre des pauvres, que décrieront des Victor Hugo ou Eugène Sue, paraît bien cruelle par rapport aux châtiments infligés aux esclaves. Pour un vol, ces derniers subissent « vingt-cinq à trente coups de fouet pour le délit qui attirerait au blanc au moins cinq ans de prison ou de travaux forcés. »
(ibid.)
Parmi les observations de Billiard concernant l'esclavage, et particulièrement la traite, on relèvera également celle-ci, qui fait partie d'un argumentaire répandu parmi les colons et certains voyageurs. C'est le constat qu'il y a peu de tentatives de fuite, par la raison que retourner à Madagascar ou au Mozambique consisterait pour les esclaves à retomber entre les mains des esclavagistes noirs qui les ont vendus aux Européens. Mieux, ou pire, l'achat d'esclaves se ferait parfois par simple humanité, car les trafiquants qui les ont négociés sur les côtes de ces pays ne s'embarrasseraient point d'un surplus de marchandise, et promettent à la mort les malheureux invendus qui leur resteraient entre les mains.
Cet argument n'est pas nouveau, il a déjà été réfuté par Condorcet. Il fait partie d'une justification générale qui tend à innocenter les acteurs de la traite, en rappelant que les Européens ne font qu'acheter en Afrique des nègres déjà réduit en esclavage, soit à titre punitif, soit par fait de guerre, pratique d'ailleurs immémoriale. L'abbé Raynal s'insurge contre cet argument avec son éloquence bien connue :
C'est vous, colons avares & paresseux qui entretenez l'esclavage en Afrique, par l'achat que vous faites de ses malheureuses victimes. Vous soufflez la guerre, en mettant un prix, non pas à la rançon, mais à la propriété sur les prisonniers. Vos vaisseaux y ont apporté un germe de destruction qui ne disparaîtra qu'avec la cessation de votre commerce abominable, ou qu'à l'excinction de cette misérable race que vous forcez à s'égorger pour de l'eau-de-vie ( volume 4, p. 173[9]).
Par ailleurs, à l'encontre des anti-esclavagistes, certains textes soulignent que le caractère universel de l'esclavage ne justifie pas que l'on s'en prenne uniquement aux colonies européennes. En 1835, deux ans après l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises, et l'année de sa promulgation à Maurice, un colon français, Renoyal de Lescouble, s'en prend dans son journal aux « philanthropes » anglais, et rappelle que la piraterie en Méditerranée continue à pourvoir en esclaves chrétiens les marchés arabes (cf. sur cette question l'ouvrage de François Moureau[11]). Dans cette diatribe intime, Lescouble souligne, comme l'ont fait par ailleurs Billiard et Thomi Pitot, que le sort des esclaves des colonies reste préférable à celui du prolétariat européen : |
Leur philanthropie aurait eu un but plus louable si elle s'était portée sur les innombrables malheureux de leur pays qui, cent fois plus esclaves que les nègres, meurent de faim et de misère autour des bureaux de philanthropie, et leurs soldats, et leurs matelots, etc. Je suis curieux de savoir comment ces braves philanthropes (braves dans le cabinet), s'y prendront pour forcer les Turcs, les Russes, les Arabes, presque toute l'Asie, tous les rois et chefs de l'Afrique, en un mot les dix-neuf vingtième de la terre, à abolir l'esclavage ( 26 mars 1835[12]).
Bernardin de Saint-Pierre, quant à lui, ne se limite pas à dénoncer l'injustice de l'esclavage et à le condamner, quitte à en rajouter un peu pour l'exemple, sur le plan éthique. Il pressent que l'esclavage n'a pas d'avenir sur le plan économique. Le coût de l'esclavage est supérieur à celui du fermage : « un habitant[13] serait à son aise avec vingt fermiers, il est pauvre avec vingt esclaves »
(
p. 57[5])
[5].
Bernardin annonce ainsi Adam Smith et Tocqueville. Pour ce dernier, l'esclavage dans le sud des Etats-Unis est une aberration économique qui est à l'origine du retard considérable de l'économie du Sud par rapport à celle du Nord. Les colons du Sud sont indolents, marqués par un mode de vie ancestrale qui ne les appelle pas à modifier leurs habitudes, et les laisse à la traîne du progrès. Les esclaves, qu'ils doivent entretenir toute leur vie pour une période limitée de vie productive, et à longueur d'année alors qu'ils n'ont besoin d'un grand nombre d'entre eux que le temps d'une saison, constituent un poids considérable dans les charges de la plantation. Au contraire, l'ouvrier du Nord n'est payé exactement que pour le temps qu'il travaille, et, de plus, il est un consommateur de produits manufacturés, tandis que l'esclave, n'étant pas significativement rémunéré, ne dépense rien ( p. 289[14] et suiv.).
L'abolition de l'esclavage est finalement décrétée en 1848 (décret du 27 avril 1848) par le gouvernement provisoire sur l'insistance de Victor Schœlcher. Trois interprétations font débat aujourd'hui : la première en attribue le mérite à Victor Schœlcher qui est intervenu avec force auprès d'Arago, évitant ainsi de reporter la décision à une Assemblée constituante dont la composition n'était pas encore établie. La seconde, qu'elle soit ou non d'inspiration hégélienne et marxiste, décrit cette abolition comme de toute façon inéluctable, compte tenu du contexte économique et politique, et du précédent britannique (l'esclavage aboli depuis 1833, la traite depuis 1807 ; puis, en France, la traite interdite en 1815 par Napoléon et Louis XVIII en 1817 à la suite du traité de Paris). On retrouve là l'éternel et insoluble débat sur le moteur de l'histoire, le rôle des personnalités dans la détermination du sens de l'histoire. Une troisième interprétation attribue la suppression de l'esclavage au rôle des révoltes d'esclaves, particulièrement dans les Caraïbes : c'est la version postcoloniale de cet événement, traduite dans les faits par la dégradation de statues de Schoelcher dans les Antilles en 1998. [15]
Journal télévisé du 23 avril 1998 sur le site de l'INA à propos du cent-cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage.