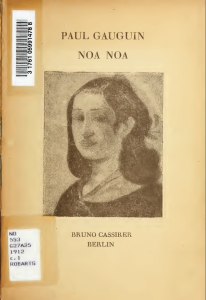Les théories du roman colonial
Il importe de donner d'emblée, dans l'ordre chronologique, la liste des publications qui vont constituer le corps de principes théoriques qui fondent le roman colonial. La plupart de ces textes sont peu accessibles, ou ont été réédités sous forme tronquée (L'Harmattan a eu cependant l'excellente idée de rééditer Philoxène[1] en 2010). Il importe donc d'y regarder de près.
Complément :
Pierre Mille est l'auteur par lequel je vais commencer, car il semble être le premier à parler de roman colonial, ou de littérature coloniale. Mais il n'a jamais composé un ouvrage complet sur cette littérature. Journaliste et romancier, il s'est contenté de publier des articles et des interviews. Des extraits de ces textes, dont le premier date de 1908, ont été publiés dans le volume Barnavaux aux colonies[2], publié chez L'Harmattan en 2002.
Louis Cario et Charles Régismanset, publient L'Exotisme, la littérature coloniale[3] en 1911.
Marius-Ary Leblond : Après l'exotisme de Loti, le roman colonial[4], en 1926.
Eugène Pujarniscle : Philoxène ou de la littérature coloniale[5], 1931.
Roland Lebel : Histoire de la littérature coloniale[6], 1931.
Pierre Mille
Pierre Mille est le créateur du personnage de Barnavaux, que Jennifer Yee décrit ainsi :
Bamavaux, c'est l'homme simple, Monsieur Tout-le-monde. Il est marsouin, ou soldat de l'infanterie de marine, et le lecteur suit à travers les nouvelles les évolutions de sa carrière mouvementée dans les colonies françaises. Raciste, noceur, méprisant des femmes et plus adonné à l'alcool qu'à la réflexion, c'est un homme simple au point d'être parfois une brute et pourtant capable de moments de pénétration psychologique surprenante. Mais plus encore que par ses propres moments fugitifs d'illumination, c'est le personnage de Barnavaux lui-même qui sert à révéler les bêtises du monde ( p. XXI[2])
Dans les nouvelles de Sur la vaste terre[8] (1905), Barnavaux et quelques femmes[9] (1908) ou Louise et Barnavaux[10] (1912), Pierre Mille met en effet en scène un personnage truculent, pris dans les rouages de l'armée et de l'administration coloniale comme son contemporain, le soldat Chveik dans la machine militaro-administrative austro-hongroise. Les deux personnages ne sont pas sans ressemblances. Simple acteur, figurant au sein de la gigantesque machinerie coloniale, Barnavaux est un "témoin[11]", au sens pictural du terme. Il est donc tout à fait intéressant que Pierre Mille, ce maître de la littérature coloniale, qui fut l'un de ceux qui bénéficièrent du titre de "Kipling français", ait adopté le prisme du regard naïf et démystificateur du soldat Barnavaux, ce Français de base propulsé aux colonies, et ne sachant les voir qu'à travers un gros bon sens ironique qui illustre assez bien cette mise en cause de la supériorité de la race blanche que Mille dénonçait dans un article[12] de la Revue de Paris de 1905. Voici ce qu'il déclare dans un article du Temps, le 19 août 1909 : |
M. Winter voudrait savoir «ce que je pense de la littérature coloniale française depuis 1870, et même plus particulièrement de la plus jeune, celle qui est éclose depuis 1900 ».
Or je professe une opinion scandaleuse. C'est qu'il est impossible de répondre parce que la littérature coloniale n'existe pas.
Ne vous frappez pas. C'est que je n'entends pas le mot dans le sens où on le prend d'ordinaire. Une oeuvre de littérature coloniale, selon moi, serait celle qui eût été produite dans un pays où les Européens sont transplantés depuis un certain temps, par un de ces Européens qui serait né, ou tout au moins y aurait vécu les seules années où l'on possède une sensibilité, où on pénètre dans leur essence la nature et les hommes: je veux dire celles de l'adolescence et de la première jeunesse. Plus tard on se contente du pittoresque et de l'utilité.
Et voilà pourquoi il y a vraiment une littérature coloniale anglaise: Kipling était un Anglo-Indien.
Mais notre littérature coloniale à nous! Elle est, du moins pour ses meilleurs ouvrages, l'ouvrage de Français de métropole ! Ce n'est pas de la littérature coloniale, c'est de la littérature de tourisme colonial. Eh oui!
Leur lecteur ne peut pas savoir si ce qu'il y trouve est vrai et l'auteur lui avoue le plus souvent qu'il y a des chances pour que ce ne le soit point, en vertu de ce principe «que l'âme exotique est impénétrable». Impénétrables furent Chrysanthème, Rarahu, Aziyadé, d'autres encore. Cela n'empêche pas d'écrire des chefs-d'oeuvre, au contraire même, parce que nous sommes encore en plein romantisme.
On m'accusera d'avoir oublié Leconte de Lisle. Oui... on lui doit le Manchy et une ou deux pièces encore d'une sensibilité sincèrement exotique. Mais tout de suite il s'est mis à décrire des condors, des jaguars et des éléphants, toutes bêtes qu'il n'avait jamais pu voir dans son île. Et il en fut de même pour le noble et pur Heredia. Ils furent de très grands poètes, mais ils ont été presque immédiatement métropolisés ( p. 171-172[2])
Cette déclaration contient déjà un élément important de la définition d'une littérature coloniale, qui reviendra de manière récurrente : c'est la définition par l'auteur, lequel doit appartenir au monde colonial, en tant que natif, ou tout au moins en tant qu'il y a longuement et intensément vécu. Mille inscrit donc dès 1909 la littérature coloniale en opposition avec la littérature exotique, ou littérature de voyage. L'Européen de passage ne peut en aucun cas se revendiquer comme auteur colonial, parce qu'il voit le monde colonial en extériorité. Comme cela se revendique dans d'autres discours, politiques, juridiques ou idéologiques, le colon, ou plus largement le "colonial", est l'autre du métropolitain.
Deuxième élément, récurrent lui aussi, c'est la représentation de l'indigène. Selon Mille, la littérature exotique, en particulier le roman, repose sur le principe de l'incommunicabilité entre les civilisations, la fameuse impénétrabilité de l'indigène, dont les scénarios romanesques jouent souvent, en particulier dans les relations amoureuses, où la pénétrabilité se limite strictement aux relations physiques. Mais l'âme indigène reste, comme le montrent les romans de Loti cités ici, inconnaissable. Or, la littérature coloniale ne saurait se concevoir sans cette connaissance profonde de l'indigène. Là encore, ce discours est extensible à d'autres domaines, les militaires eux-mêmes ne pouvant vaincre qu'un ennemi qu'ils connaissent bien. Enfin, comme on le voit, Mille a déjà choisi les deux auteurs de référence qui vont aimanter, comme des pôles antagonistes, les définitions de la littérature coloniale : Kipling, le modèle anglais, et Pierre Loti, le contre-modèle français. |
Louis Cario et Charles Régismanset (1911)
L'urgence du voyage
Si le voyageur et le colon peuvent constituer des figures antagonistes, le voyage est bien entendu en soi une valeur, et les auteurs de citer en raillant Mme de Staël : « Voyager est un des plus tristes plaisirs de la vie »
.
L'ouvrage est divisé en deux livres esquissant une histoire de l'exotisme : dès l'ouverture du premier, « Les origines », les auteurs tentent de montrer que le mouvement est dans la nature de l'homme :
Pour l'humanité, immobilité est synonyme de mort. Le torrent aux flots toujours mouvants, descendant de la montagne vers les fleuves et les mers nous dit le rythme de la vie: Ahasvérus [le Juif errant] est un symbole éternel et Nietzsche, à bon droit, s'écrie dans son Ecce homo: "Etre assis le moins possible, ne pas ajouter foi à une idée qui ne serait venue en plein air, alors que l'on se meut librement. Il faut que les muscles, eux aussi, célèbrent une fête !"
Voilà une première justification métaphysique et universaliste du voyage puis de la colonisation. Celle-ci, selon un essai de Carl Siger[15] (en réalité pseudonyme de Charles Régismanset) cité dans l'ouvrage, se révèle constituer le bout d'une chaîne dont les origines remontent à l'homme primitif même : |
L'homme primitif, riche seulement d'instincts, dépourvu de traditions ancestrales, pauvre de moyens et déjà tourmenté par un infini de désirs, ne connaît pas encore l'art de remédier par la culture, le commerce et l'industrie, autrement dit, par la volonté de l'expérience acquise, à l'épuisement rapide du sol qui le nourrit, à la rigueur de l'atmosphère.
La forêt abattue, le troupeau décimé, le ciel devenu trop inclément, il porte plus loin sa tente.
Cette migration individuelle, avec le peuplement progressif, se mue en migration collective. Ce sont des foules et des hordes qui parcourent le monde, poussées par l'instinct et la nécessité ( p. 9-10[3])
C'est une autre motivation du voyage, voire de la conquête : un instinct naturel, un besoin irrésistible, un facteur humain, qui avait d'ailleurs été déjà décrit par l'auteur de l'article Colonie[16] de l'Encyclopédie : la colonisation n'est pas le fait des seuls Européens, elle a toujours déjà marqué l'histoire de ses développements sur tous les continents. Bien entendu, ajoutait l'auteur, ce sont les plus forts qui dominaient les plus faibles.
La seconde motivation est elle aussi originaire. C'est la curiosité, l'attrait de l'inconnu et du lointain. D'entre ceux qui partent « quelques-uns reviennent qui disent les villes rencontrées, les civilisations pressenties ou devinées, les merveilles entrevues, d'autres hommes, d'autres mœurs ; héros grandiloquents dont le verbe enthousiaste magnifie les réalités et provoque une intense suggestion collective, un puissant mirage »
(p. 12)
Ces récits vont faire l'objet d'une « première littérature, une ‘littérature de voyages' »
, qui peut aller de modestes carnets de notes à des chefs-d'œuvre, car, selon
Henri de Régnier[17] invoqué : « les plus beaux livres de voyage n'ont pas été écrits par des voyageurs de profession »
(p. 13). Incontestablement, la relation de voyage, redécouverte et réannexée récemment par la littérature, est souvent le fruit de collaborations. On sait le rôle que Defoe a joué dans la rédaction des Aventures de Robert Drury, par exemple, au point qu'on a été jusqu'à douter de l'existence réelle du voyageur (voir
mon article[18] et ses renvois bibliographiques). Mais à l'époque où Cario et Régismanset écrivent, la littérature de voyage n'est encore visitée que pour sa valeur documentaire. Or, s'il s'agit ici de poser les fondements d'une littérature coloniale dans le sens le plus noble du terme. De là la préférence des auteurs pour les poètes inspirés par l'exotisme, comme Henri de Régnier, Baudelaire ou Porto-Riche.
Qui est ce que ce voyageur romancier ou poète, qui doit cumuler les qualités du voyageurs et celles de l'écrivain ? Qu'est-il en lui même, dans ses qualités essentielles ? Un aventurier, amateur de mouvement, de changement, d'imprévu, de nouveauté, le contraire de son sédentaire et bourgeois lecteur qui se devine en filigrane dans le texte de Cario et Régismanset. Et de reproduire, entre deux sonnets de Baudelaire, ces vers étonnants de Porto-Riche :
Ah voyager, Tiani, changer d'air et de femmes ;
Ne plus voir les objets qu'on avait sous les yeux
Voir des hommes nouveaux qui ne valent pas mieux,
Mais qui semblent meilleurs ; paraître et disparaître
Voguer comme un forban, chevaucher comme un reître
Voir des villes, des monts, des prés, des châteaux-forts,
Et posséder, les soirs où nous sommes très forts,
Dans des lits inconnus, en rêvant d'amours neuves,
Des vierges quelquefois et fréquemment des veuves (p. 15)
Ces vers, parmi tant d'autres, rappellent les ingrédients indispensables à une bonne littérature exotique. Celle-ci s'appuie, une fois encore, sur une demande d'ailleurs et d'altérité inhérente aux origines mêmes de l'humanité occidentale, comme l'écrit Ernest Babut :
L'exotisme est partout où les paysages sont différents de ceux qui servent de cadre à la vie de notre race, partout où les hommes nous paraissent être moins nos semblables [...] Car, nous gardons au fond de nous une nostalgique dilection pour les pays du soleil. Le vieux rêve sémite a passé sur notre âme aryenne et il y a laissé le mirage de ses jardins paradisiaques, lumineux et tièdes dans leur splendeur équatoriale. Puis, nous subissons toujours l'hérédité millénaire de cet instinct qui oriente sans cesse l'exode de nos races, filles du nord glacé, vers le cœur brûlant de la terre. Enfin, la littérature exotique satisfait encore ce perpétuel désir de la lointaine aventure, reste de l'esprit nomade de nos primitifs ancêtres. (cité p. 17)
Il y a dans ce passage deux éléments à retenir particulièrement : d'une part, une définition sensiblement réductrice de l'exotisme, fondée sur la simple différence. Secondement une justification héréditaire de la pulsion exotique rattachée à une théorie des premiers temps du nomadisme humain dont nous serions les héritiers.
Enfin, la littérature de voyage n'exige pas seulement l'observation et le discours rapporté de cette observation, mais surtout le génie propre, la subjectivité talentueuse des peintres de l'ailleurs : « Ce que nous leur demandons, à ces témoins de l'univers, c'est la peinture exacte de ce qui est. La qualité de leur vision nous intéresse presque même davantage que la matière de ce qu'ils voient »
(p. 13).
Ce qui prépare l'interrogation sur la littérature coloniale, c'est d'abord cette contradiction inhérente à la littérature exotique : d'un côté, celle-ci mise sur la subjectivité du voyageur, ses "impressions", ses "souvenirs" bien entendu sélectifs et focalisés, ces deux mots revenant très souvent, comme on sait, dans les titres des ouvrages exotiques.
Vers une littérature coloniale
Le deuxième livre s'intitule « L'activité coloniale » et va donc poser les bases, succédant à la littérature de voyages et à la littérature exotique, d'une nouvelle littérature.
L'activité coloniale, dont les auteurs brossent un bref historique (p. 159-164) n'arrive à son plein développement que sous la troisième République. A côté des motivations économiques et politiques, les auteurs suggèrent, en lieu et place, mais ne la contredisant pas nécessairement, de la vocation humanitaire qui constitue le troisième terme de la politique coloniale exposée par Jules Ferry en 1885, l'influence d'un moteur « moral » :
[ce moteur moral] est constitué par l'influence des récits des grands voyageurs du siècle, qui continuent l'œuvre des hardis pionniers des siècles précédents.
L'élargissement progressif du monde, dit civilisé, se manifeste ainsi sous la forme de suggestions étendant leurs ondes, du sujet à l'objet et de l'objet au sujet. Le mirage des pays lointains appelle les explorateurs, qui à leur tour font école. Il y a là un mimétisme très puissant, d'autant que fixé et magnifié par la fiction ou le récit littéraires. Tels hommes partent au loin, la simple ambition personnelle déçue, ou quelque désillusion sentimentale y suffit parfois, et c'est un empire nouveau qui se lève. La fantaisie d'un individu s'exerce et, du même coup, le domaine de son pays s'augmente (p. 163).
Facteur décisif au cœur de l'expansion coloniale : la vocation individuelle, sachant qu'elle même est déterminée par les lois collectives, sociologiques, qui sont celles qu'a décrites en 1890 Gabriel de Tarde dans Les Lois de l'imitation[19], et qui utilise largement l'analogie des vecteurs d'imitation avec les ondes physiques.
Le voyageur, dans son hypostase d'explorateur, dans sa version découvreur, est ici un moteur de colonisation, dans un jeu d'aller-retour maintes fois décrits dans les vocations coloniales ou simplement de voyage : de Gide, rappelant le souvenir de son oncle missionnaire dont les récits l'enthousiasmèrent bien longtemps avant son départ pour le Congo, aux élèves de l'école coloniale ou de la France d'outremer avouant que leur vocation est née lors de leur visite, enfant, à l'exposition coloniale.
Ce type de littérature, aventureuse, est représentative, selon Régismanset, d'un première période de la littérature de voyages contemporaine : « Littérature de découvertes et de conquêtes » (p. 163). A cette littérature succèdera bientôt, une fois le temps de l'aventure terminé et venu « Le moment des ‘ utilisations ‘, des ‘exploitations' »
(p. 164) une littérature plus vaste, plus diversifiée, dans laquelle Régismanset englobe aussi bien des ouvrages techniques, scientifiques, de vulgarisation que de littérature de fiction. La question est donc désormais de définir la « littérature coloniale » qui est située au terme d'une évolution nécessaire.
La littérature de voyage se transforme donc avec l'avènement du XIXe siècle : Bory de Saint-Vincent, par exemple, inaugure « la littérature exotique à tendance scientifique et documentaire »
(p. 167), et une littérature monumentale avait été publiée à la suite de l'expédition d'Égypte (les vingt-six volumes de la
Description de l'Égypte[20]). Tout au long du XIXe siècle, une production considérable de récits de voyage, à caractère scientifique ou au moins documentaire, et dont les auteurs font l'énumération sur une dizaine de pages, connaissent un succès croissant auprès du public, comme en témoigne Lanson :
Tous ces ouvrages sont accueillis avec empressement, et il faut qu'ils soient bien médiocres pour n'obtenir aucun succès. Il semble que le public soit las de fictions et savoure la certitude de la réalité des récits et des descriptions que ces sortes d'écrits lui offrent. Il semble aussi que son éducation esthétique soit au point qu'il est apte à extraire lui-même d'une matière brute les possibilités de plaisir littéraire qu'elle contient, et qu'il se plaise à faire ce travail plutôt qu'à le recevoir tout fait d'un artiste habile. Il cueille la psychologie et le pittoresque épars dans toutes ces écritures, et, si peu qu'il en récolte, son effort, autant que son gain, le contente. Enfin, il est vrai aussi que la frivolité d'esprit, l'inaptitude à penser trouvent leur compte à ces lectures qui ne présentent que des choses particulières. (cit. p. 176-177)
Cette nouvelle littérature de voyage est donc la marque de changements d'orientation du goût du public, qui, selon Régismanset, non seulement s'est lassé d'une certaine frivolité littéraire (en particulier le roman psychologique et mondain), mais désire joindre au plaisir d'exotisme un profit matériel, documentaire. Pour résumer ce qui précède et anticiper sur ce qui va suivre, on peut dire que le lecteur de passif est devenu actif, de sédentaire, voyageur au sein même de sa lecture. Il choisit dans le texte au lieu de se laisser guider par une narration ou un raisonnement. Il fait son marché, il va lire comme on va au bazar, choisir à tout moment entre l'utile et l'agréable.
Suivent alors dix nouvelles pages d'indications bibliographiques sur les colonies, du point de vue politique, économique et juridique, voire géostratégique, comme l'ouvrage d'Onésime Reclus, inlassablement cité depuis comme l'inventeur du mot « francophonie » : Lâchons l'Asie, prenons l'Afrique[21] (1904).
Après ce chapitre consacré aux « Voyageurs et techniciens », Cario et Régismanset se penchent sur les "littérateurs" pour en extraire l'incontournable figure de Loti parmi une longue liste d'auteurs. S'appuyant sur Lanson, qu'ils citent longuement, ils font de Loti un portrait de voyageur "isolé" dont la principale idée sera reprise par Leblond et Lebel :
Il exprime son moi dans un décor exotique comme il l'eût exprimé dans tout autre cadre. Nulle objectivité, tout ici est interprétation et ne vaut que comme interprétation. Le monde est vraiment la représentation de l'auteur, rien d'autre. Aussi bien, au point de vue de la littérature exotique, Loti n'a-t-il point fait école. Il n'apporte ni une doctrine, ni une méthode, ni un procédé. Il est un splendide isolé (p. 199).
C'est dans cette subjectivité, ce regard qui ne pénètre pas, ce monde en trompe-l'œil que Marius-Ary Leblond, tout en partageant leur admiration pour Loti, vont trouver le repoussoir à ce que doit être la littérature coloniale. A Pierre Mille, ils empruntent l'opposition littérature touristique vs littérature coloniale, opposition que l'on retrouvera chez Leblond (qui sont les seuls auteurs authentiquement coloniaux selon Mille) et Lebel.
Marius-Ary Leblond (1926)
Paru en 1926, et par conséquent plus tardif que les précédents, cet ouvrage[4] doit être replacé dans le contexte d'après-guerre et des "années folles". On y retrouvera, certes, plusieurs des éléments qui ont été déjà affirmés par les prédécesseurs, mais c'est vraiment à cette époque que la revendication d'une littérature proprement coloniale va s'affirmer. Lisons les premières pages de l'ouvrage :
Tant de Françaises et de Français très lettrés qui jusque-là n'avaient jamais voulu ouvrir un atlas, durant la Guerre n'ont cessé, d'un cœur passionné, de suivre les cartes et de réclamer des livres les renseignant sur les pays où se battaient nos troupes et nos alliés: on s'attendait à un épanouissement de la sensibilité et un à élargissement de la littérature après la Guerre ! Vraiment l'on espérait d'autres modes artistiques que celles qui ont fleuri sur les terrains vagues des Traités de Paix. Le Dadaïsme ou le nouvel Humourisme [le surréalisme] qui en est le succédané peuvent procéder de raisons profondes, car ils s'épanouissent avec luxuriance, mais tout juste émergent-ils de la Vague de Plaisir qui suit toujours les grandes catastrophes.
C'est une nouvelle humanité que nous réclamons ! A la vérité, ce ne sont point ses images rosses ou quelque cubisme de syntaxe qui firent le succès mérité de Paul Morand, mais la fixation, dans un style constitué par une cinématographique psychologie passionnelle, des types européens de l'après-guerre. Le public a voulu connaître les Irène de la nouvelle Byzance des Affaires, goûter aux Arianes russes, lutiner Margaret d'Oxford, posséder la Vénus Internationale : le roman cosmopolite a fait des progrès européens. De son côté, le roman colonial s'est développé avec force, et l'immense diffusion de Batouala ne lui est pas tant venue de sa préface polémique que d'une pénétration érudite de la mentalité et de l'érotisme des Noirs les plus primitifs de notre Afrique, dressés en un livre concis avec un style lucide. La vogue a favorisé les romans coloniaux au point que le Ministère, sortant de sa maladie du sommeil officielle, a créé un Grand Prix de Littérature Coloniale, très recherché et qui a lancé déjà plusieurs auteurs, de Jean Marquet à André Demaison1 [...]
Ce que soulignent d'abord les Leblond, c'est cette déception d'une époque de frivolité qui a suivi le carnage de la Grande Guerre. Et particulièrement en littérature, où des auteurs à succès publient des romans cosmopolites et d'aventure, dont les Leblond évoquent indirectement les titres récents bien connus des lecteurs : Ariane, jeune fille russe[22] de Claude Anet (1920), La Vénus internationale[23] de Pierre Mac Orlan (1923), Oxford et Margaret[24] de Jean Fayard (1924) et Lewis et Irène[25] (1924) de Paul Morand. Au moins, ces romans insufflent-ils dans le public un goût d'ailleurs et de voyages. Et, selon les Leblond, le roman colonial, qui procède d'autres motivations et surtout d'une autre esthétique connaît, pour la même période un succès croissant, dont témoigne particulièrement Batouala, de René Maran, prix Goncourt 1921.
Complément : Romans coloniaux remarquables cités par Marius-Ary Leblond (p. 4-5)
Jules BOISSIERE : Fumeurs d'opium (1896, réédité chez Louis Michaud en 1909) ; Albert de POUVOURVILLE : L'Annam sanglant, 1896 ; Louis BERTRAND : Le Sang des races, 1899, paru d'abord à La Revue de Paris ; Paul CLAUDEL : Connaissance de l'Est, 1900 ; Paul GAUGUIN : Noa- Noa, 1902, Ed. de la Plume, réédité chez Grès avec illustrations en 1924 ; Marius-Ary LEBLOND : Les Sortilèges (1902, dans la Revue Blanche et la Revue de Paris) ; Le Zézère, 1903 ; Jean AJALBERT : Sao Van Di, 1905 ; Robert RANDAU : Les Colons, 1905 ; Pierre MILLE : La Vaste Terre (où parait déjà Barnavaux), 1906; Barnavaux et quelques femmes, 1908; Louise et Barnavaux, 1910 : trilogie ; Max ANELY (Victor Segalen) Les Immémoriaux, 1907.
On ne peut donc plus affirmer, comme le faisait Pierre Mille en 1908 que la littérature coloniale n'existe pas. Et même, à voir les textes cités par les Leblond, dès cette époque, la déclaration était exagérée. Désormais, le roman colonial est une réalité, et il est vrai que certains romans connaissent de nombreuses rééditions et des traductions comme les Barnavaux de Pierre Mille, ou encore Louis Bertrand. S'il peut être confondu, dans le goût du public, avec la littérature exotique, la littérature de voyage ou la littérature cosmopolite, il n'en dispose pas moins de caractéristiques propres, que d'autres auteurs avant les Leblond avaient énumérées en partie, comme le lien étroit entre littérature coloniale et finalement politique coloniale, la première étant nécessairement une expression et une conséquence de la seconde. Cette dimension idéologique ne sera jamais absente de la théorie littéraire des Leblond. |
Mais ayant plus de recul sur la question, ils peuvent la rattacher à un autre courant, à la fois idéologique et littéraire, qui s'est développé dans les premières années du siècle et qui est le régionalisme :
Deux besoins essentiels du public, du pays, dominent l'évolution du genre : on sent que la France ne peut plus tenir son rang en Europe, ni peut-être même vivre, qu'en s'appuyant sur son empire d'outre-mer, qu'il lui faut s'attacher étroitement et durablement cet empire. D'où approfondissement de l'Exotisme qui était surtout chez Loti un déploiement de décors, un enrichissement de l'individualisme et un impressionnisme orientaliste en Littérature Coloniale. Le Colonialisme devient la plus grande Province du Régionalisme (p. 7-8).
Comme l'a montré Anne-Marie Thiesse[27], les dernières années du XIXe siècle ont vu se développer un mouvement régionaliste dont les revendications sont à la fois culturelles, littéraires et idéologiques. Sans entrer nécessairement en contradiction avec les idéaux de la troisième République, dans la mesure où ils remettent en valeur la paysannerie et l'enracinement qui constituent au total la Nation française, les régionalistes vont tenter de développer, à travers des revues et des publications décentralisées, la province en concurrence avec Paris. C'est en 1911 que Jean Charles-Brun publie son ouvrage sur le Régionalisme[28], où il écrit :
Par la double vertu du sol et de l'histoire commune à ses ancêtres, l'écrivain provincial peut saisir tous les caractères qui constituent la figure de sa province : par une étude volontaire et passionnée, il peut dégager en lui-même les linéaments un peu effacés, peut-être, de sa personnalité. Une qualité propre d'imagination et un choix d'images empruntées au fonds populaire, aux phénomènes météorologiques, à la faune et à la flore du pays, une qualité propre de sensibilité, une conception particulière de tous les grands problèmes, une véritable philosophie, car un Languedocien n'entend pas de même qu'un Breton la nature, l'amour, l'infini ou la mort ; enfin une connaissance exacte des mœurs, si précieuse pour colorer un récit et le «situer» dans l'espace, en voilà plus qu'il n'en faut pour assurer cette inappréciable variété que nous recherchons. [ ... ] On peut croire que le salut des lettres françaises est à ce prix (cité par Anne-Marie Thiesse, "L'invention du régionalisme", p. 31[27])
Le salut de la France est aussi, on l'a vu, dans les colonies. Cela dit, les Leblond ne veulent pas être assimilés aux régionalistes, car si ceux-ci veulent mettre en avant la province et son potentiel créatif qui est littéralement aspiré par la capitale, les coloniaux ne peuvent considérer l'outre-mer tout à fait comme une province. Il y a là une contradiction interne dont il faut s'échapper. Les provinces ont besoin de s'affirmer contre l'hégémonie parisienne, mais les colonies n'ont d'existence et de sens que par référence à la France et à sa capitale politique dont elles sont l'expansion lointaine. La littérature coloniale sera donc à la fois un régionalisme, car les écrivains y décrivent des mœurs spécifiques, et dans le même temps une expression vigoureusement nationale :
Par l'étendue de son domaine, par l'altruisme de son sentiment, par la qualité de son inspiration où l'imagination n'est que l'invitation au voyage de la sensibilité, le Roman Colonial ne souffre donc point d'écoles. Si le Régionalisme manifeste souvent contre Paris, la Littérature Coloniale ne s'oppose pas plus à Paris qu'à la province : elle s'inspire du génie de toute la France, de la France totale, de la Grande France (p. 12)
Et cependant, les buts et les moyens ne manquent pas d'analogies. Par exemple, le développement de la littérature régionaliste doit bénéficier de conditions qui sont tout à fait comparables à celles que l'on va tenter de développer pour la littérature coloniale : création de Sociétés, de chaires universitaires, d'associations, de prix littéraires :
Le mal qu'aura fait l'atmosphère corruptrice de Paris, c'est à la province qu'il appartiendra de le guérir. Elle ramènera le règne de l'art [ ... ]. Par quels moyens propager cette décentralisation (en admettant qu'elle existe déjà, ce qui paraît douteux) ? Par la création de huit ou dix grands centres universitaires qui serviraient de cadre à des groupements intellectuels - par la fondation sérieuse de revues, pas trop nombreuses (une par centre), largement ouvertes, non pas seulement à des états d'âme sans intérêt, à des essais informes, à des vagissements de nourrissons des Muses, mais à des idées pratiques, à des enquêtes fécondes [ ... ] - par l'organisation de salons de peinture, de concours littéraires, sous le patronage d'académies qui seraient autre chose que des asiles de vieillards ou des sociétés d'admiration mutuelle - en définitive par l'union de talents et de forces qui s'usent et se perdent dans des tentatives toujours stériles parce qu'elles sont trop isolées (Henri d'Alméras, cité par Anne-Marie Thiesse, Ecrire la France[29], p. 51)
Les Leblond se félicitent de la création d'un Grand Prix de Littérature Coloniale en 1921. Outre le fait que nous sommes dans une période où les prix littéraires se développent et se disséminent — depuis le prix Goncourt, 1903 (que Marius-Ary Leblond obtiendront en 1909, voir mon article[30]) et le prix Femina, 1904 jusqu'au prix Renaudot qui est créé cette même année 1926. Les Goncourt n'ont pas inventé le prix littéraire, mais ils l'ont arraché au monopole de l'Académie française, et en ont fait un outil de promotion et de développement littéraire dont l'efficacité est venue avec le temps. D'où le ralliement de l'Académie française qui s'aligne sur ses rivaux en créant le Grand prix de Littérature, biennal, en 1911, mais aussi le développement des prix dans les sphères provinciales. La Société des écrivains de province crée en 1920 un prix littéraire annuel décerné à des textes encore inédits (Anne-Marie Thiesse, p. 118 et suiv[29].). La création du prix de littérature coloniale, qui sera suivi du Prix des Français d'Asie, et de bien d'autes, s'inscrit donc bien dans ce contexte, et il est salué comme une institution nécessaire par Pujarniscle ( p. 185[5]) ou Lebel ( p. 75[6]).
Lamentations de l'écrivain colonial. Eugène Pujarniscle décrit l'écrivain colonial à la recherche d'un éditeur (Philoxène ou de la littérature coloniale, p. 183-184) :
L'identité du roman colonial
La littérature coloniale se définit comme un approfondissement de l'exotisme qui n'était, par exemple chez Loti, que « déploiement de décors, [...] enrichissement de l'individualisme et [...] impressionnisme orientaliste »
(p. 7). On retrouve donc ici cette parenté entre le roman exotique et le roman colonial, mais les Leblond mettent plus qu'on ne l'a fait auparavant l'accent sur la rupture, ainsi que sur le choix esthétique prescrit aux romanciers.
La littérature coloniale se placera sous le signe des écrivains réalistes : Balzac, Zola, Bourget qui sont cités par Leblond :
Aujourd'hui, dans le roman colonial nos camarades et nous entendons révéler l'intimité des races et des âmes de colons ou d'indigènes n'est plus seulement une machine à décors et une matière à aventures, il aborde les revendications et les grands problèmes sociaux ou spirituels qu'on ne trouvait jusqu'ici que dans les romans métropolitains des Balzac, des Zola ou des Bourget. Beaucoup d'entre nous, révoltés d'être traités en cousins pauvres, demandent que le public français s'intéresse aux héros jaunes ou noirs des romans coloniaux, aux aspirations et souffrances des sujets de nos territoires (p. 8).
Plus précisément encore qu'au réalisme, c'est au naturalisme qu'on pense en lisant les Leblond : ils n'hésitent pas, au moins dans leurs premiers romans, à user d'un style maniériste proche des Goncourt, et du néologisme comme on peut le lire dans La Sarabande[32], publié en 1904 :
Rivière s'était dérobé par une porte du fond de la cour. Après l'effervescence d'une chute de Digue, la foule reposée s'écoula lentement par le grand barreau, comme une eau lente à travers des herbes de Job. Les cervelles vaseuses étaient encore fécondées d'un flux nouveau d'idées et de phrases, et la conversation, comme après une crue, était montée de ton, ronflait. Mais les groupes se divisaient aux angles : des irrigations paisibles s'éparpillaient par la ville, canaux à peine chantants sous les grands ombrages.
Bettine, sorti des premiers, stationnait avec Mussard sur le trottoir, regardant de son profil goguenard et dandinant défiler les groupes jaseurs. Il arrêta Tambilla qu'accompagnait sa femme. Grande, la peau fauve, la tête crêpée d'une tignasse rutilante, elle était hautaine et voluptueuse; un roulis lascif et dédaigneux balançait ses hanches sous la blouse à moitié ceinturée. Elle avait la gorge dure et brusque. La figure grêlée était insolente de savoir que l'homme est indifférent au visage, si le corps promet. Les lèvres humectées et l'œil salace, elle dévisagea Bettine [...]
Thérésine avait été bonne dans deux maisons et gardait la haine enflammée des femelles blanches. Les deux fois elle avait été chassée, soupçonnée de servir aux maris, et elle mettait à l'emploi de sa haine de classe le goût de sa chair entumorée pour les hommes blancs qu'elle savait enlever au ménage régulier (p. 24-25).
Il reste que dans leur empressement à définir une esthétique propre au roman colonial, les Leblond manient la contradiction avec une certaine intempérance. Naturalistes ? oui, au sens où ils se reconnaissent "élèves du naturalisme" (
p. 16[4]) ; mais c'est aussi bien pour dire, quelques pages plus loin, à propos de Pierre Mille : « Grâce à lui le roman colonial, au lieu de croupir dans la satire naturaliste, s'est exalté à l'enthousiasme et a tiré de la poésie autant que Michelet de l'histoire une morale de résurrection »
(p. 20). Réalisme ? Certes, mais d'un réalisme qui n'exclut pas l'idéalisme : « Du réalisme se dégage naturellement l'idéalisme, car il excelle à faire rayonner l'inconnu, l'inédit, en un mot, le merveilleux des hommes et des choses d'outre-mer, presque d'outre-monde... »
(p. 12), et qui répugne à certaines réalités comme : « la hideuse rocambole d'un faux réalisme puisé aux bavardages des bouges saïgonnais ou des popotes algéroises »
(p. 63). Réalisme et surréalisme ne sont d'ailleurs pas incompatibles : « Loin de se contredire, réalisme et surréalisme se commandent et l'un de l'autre se nourrissent »
(ibid.). La voie est donc étroite pour un roman colonial qui doit être vrai dans ses analyses, pittoresque s'il le faut (
« Les Sortilèges »
[33]« appliquent le réalisme l'observation des mœurs coloniales mais pour l'élever à la personnalisation pittoresque de l'âme des races »
, p. 44), étrange et scientifique, poétique et social tout à la fois.
Enfin, dans son analyse des indigènes, et de la rencontre avec les Européens, le roman colonial ne peut ignorer la vogue du primitivisme, qui, là encore, peut s'apprécier contradictoirement. Non au primitivisme d'un Charles Renel, racontant dans
Le Décivilisé[35] l'histoire d'un instituteur de la brousse, qui finit par se fondre dans la vie villageoise et renoncer à la civilisation : |
Noa-Noa n'est pas un roman tahitien : c'est le journal de Paul Gauguin à l'ombre de la case de bambou sous les manguiers sacrés, au large des mers poissonneuses, au profond des bois aromatiques, au vif des ravines polynésiennes. Nulle prétention littéraire : le parfum de la plus touchante et saine sincérité. Presque pas de paysage, plutôt de la psychologie aisée, incisive, intuitive de l'âme maori. C'est, par la curiosité néophyte des religions et mythologies indigènes, une œuvre : elle marque excellemment l'histoire d'une âme d'artiste européen avide, par conversion, de rentrer en la beauté et la bonté de la nature. Ce pieux petit livre panthéiste sert à éclairer d'un sens primitiviste la mission de la peinture exotique. Au demeurant ce livre de peintre fit, lui aussi, date à l'issue du Symbolisme, clair évangile de vie idyllique décrite de bonne foi sans la raideur parnassienne ni l'emphase romantique : mieux qu'invitation au Voyage cet appel à l'Eden, un siècle après Rousseau, étendait à l'art la portée de son primitivisme social et donnait au Retour à la Nature la beauté d'un hiératisme religieux (p.52).
Les Immémoriaux : ce roman de l'âme tahitienne accuse la différence profonde de notre génération avec celle de Loti. L'exotisme n'est plus ici l'extrême province du Romantisme nomade cherchant ses nostalgiques émotions en des îles lointaines comme des rêves de l'original Eden. C'est chez un ultra-civilisé, non pas seulement comme Loti par la sensibilité mais par la cérébralité, par la culture la plus intense et érudite, le besoin fiévreux de revêtir l'âme des plus vieilles humanités : très sceptique vis-à-vis des traditions européennes, Segalen, quand il s'agit des théogonies ou théocraties maories ou mongoles, est pris d'un fanatisme de curiosité qui va jusqu'à la mysticité (p.53)
Eugène Pujarniscle (1931)
Après les ouvrages que nous avons commentés, au moment où se prépare l'exposition coloniale de 1931, Pujarniscle, écrivain et enseignant, entend "définir" la littérature coloniale, préjugeant ainsi que, jusqu'alors, les définitions ont manqué de contours et de netteté. Mais tandis que les ouvrages précédents étaient plutôt prescriptifs, Philoxène[5] se révèle davantage descriptif et critique, en faisant la part dans la variété des romans coloniaux, tant de ceux qui sont littérairement (et colonialement) les plus remarquables, que des romans de moindre valeur. L'avantage est qu'on trouvera dans l'ouvrage de Pujarniscle une analyse bien plus documentée que chez ses prédécesseurs.
Le point de départ de la littérature coloniale est, dans la perspective de Pujarniscle, avant tout la propagande. Une propagande que tous les coloniaux, qui se jugent mal aimés et mal compris, ont eu le soulagement de voir se développer seulement depuis quelques années. Or, pour être efficace, la propagande doit plaire, et c'est une fonction que l'image et la littérature, la littérature parce qu'elle est nourrie d'images, peuvent seules remplir efficacement.
Une propagande suppose un public qu'elle vise et entend convaincre. Or ce public, et c'est le premier paradoxe de la littérature coloniale, n'est pas dans les colonies. Les coloniaux sont "dispersés", et peut-être aussi peu liseurs. Il faut donc, alors qu'on écrit dans le cadre d'une littérature définie comme coloniale, séduire un public métropolitain, c'est-à-dire au bout du compte parisien.
Cependant, Pujarniscle ne veut pas tout sacrifier à la propagande, et surtout pas la vérité. Il n'est que trop évident qu'écrire pour un public auquel on veut plaire peut conduire à lui servir les stéréotypes auxquels il doit s'attendre. Dans une page finement ironique, Pujarniscle raconte l'histoire convenue de la congaï séduite et abandonnée par l'Européen et sa conclusion suicidaire. Il existe effectivement des romans qui répondent très exactement à cette trame : c'est évidemment celle de la nouvelle de John Luther Long, "Madame Butterfly" (1898) qui est à l'origine du célèbre opéra de Puccini. Il en existe des variantes, comme Thi-Bâ, fille d'Annam (1920)[37], de Jean d'Esme : tout est bien conforme sauf que le Français n'abandonne pas volontairement la congaï. Il meurt à la guerre. |
Autrement dit, être vraiment colonial, c'est échapper aux préjugés des continentaux. Mais être vraiment littéraire, ce serait éviter ceux des coloniaux. La voie, une fois encore, est étroite ...
La même opposition colon/voyageur, colonial/exotique, réaliste/romantique, déjà présente chez Pierre Mille et chez Lebond se retrouve ici : « Partout [Loti] ne fait que passer. Le colon s'installe »
(p. 16, pagination de l'édition originale)". Je n'y insisterai donc pas.
La finesse de l'analyse de Pujarniscle réside plutôt dans le démontage des éléments qui constituent, ou devraient constituer la littérature coloniale, prise dans ses contradictions. Le colonial, certes, est l'autre du métropolitain, mais il a été un métropolitain. Il est nourri de littérature et sa vision du monde exotique est toujours déjà littéraire. Sous l'influence des auteurs romantiques français, « on a dû inventer les champs, les forêts, les montagnes et la mer ; on a dû aussi inventer les Tropiques »
(c'est l'auteur qui souligne). Ainsi, note Pujarniscle, si le colonial a appris avant de partir aux colonies que la végétation était "luxuriante", comment éviterait-il d'employer lui-même dans un roman l'expression "végétation luxuriante" (p. 38), sinon en luttant contre ce syntagme induit ? Pujarniscle a compris que la littérature coloniale est tributaire de ce qu'on appellera plus tard l'intertextualité.
Trois éléments sont constitutifs du roman colonial : la nature, qui à la fois diffère et ressemble, surprend tout autant par son exubérance que par sa monotonie, par sa ressemblance (avec les paysages de France) que par ses différences irréductibles. Pujarniscle analyse dans le chapitre consacré à la nature avec beaucoup de finesse le discours romanesque, non tant seulement colonial que sur les colonies. Mais aussi les hommes, c'est-à-dire les coloniaux et les indigènes.
Si le colonial n'est jamais qu'un ancien (et souvent un futur, Pujarniscle cite Nostalgie et futurisme[38]) métropolitain, il subit, en se déplaçant, en s'exilant, ou mieux en se transplantant, en se déracinant, des transformations dont le roman colonial doit rendre compte, aussi bien du côté de l'écrivain colonial que de ses personnages coloniaux. Si l'on a conscience de la différence de l'indigène à l'Européen, on doit aussi tenir compte d'une différence considérable du colonial à l'Européen. C'est aussi un autre.
Mais c'est l'indigène dont la place doit être assurée dans le roman colonial, non pas comme un personnage secondaire et subalterne, une ombre passante parmi les décors, comme c'est trop souvent le cas, selon Pujarniscle, dans maint récit colonial. A l'inverse, s'il est talentueux et lucide, |
Après avoir abordé la "matière" coloniale, Pujarniscle s'attache à en décrire la forme, dont la qualité lui paraît essentielle. C'est ici qu'il fait un tri critique, rejetant la littérature scientifique, les mémoires, les journaux de voyage, pour ne retenir que le roman, et encore, en rejetant le roman facile. Quelques questions de style se posent alors, fondée sur le principe que |
Roland Lebel (1931)
Complément : Quelques ouvrages d'histoire littéraire et d'anthologie coloniales jusqu'au début des années 1930
Martino, L'Orient dans la littérature française [1906][42] [41]
Leblond, Anthologie coloniale [1906][43]
Chinard, L'Exotisme américain dans la littérature française [1911][44]
[41] Lebel, L'Afrique occidentale dans la littérature française [1925][41] [41]
Tailliard, L'Algérie dans la littérature française [1925][45]
Bordeaux, Voyageurs d'Orient [1926][46]
Barquissau, Le Roman colonial français [1926][47]
Lebel, Le Livre du pays noir (anthologie) [1927][48]
Roland Lebel (1931)
En 1931, l'année donc de la grande exposition de Vincennes, une
Histoire de la littérature coloniale[6] est particulièrement bienvenue. Elle est une première, puisque, selon l'auteur : « la littérature coloniale française ne date guère que du XIXe siècle et plus précisément, de la seconde moitié du XIXe siècle. Auparavant, elle se confond avec l'histoire de l'exotisme »
(p. 7).
Les histoires et les anthologies précédentes s'attachent d'abord à étudier cette thématique bien connue de l'Orient ou l'exotisme, ou l'Algérie, etc. dans la littérature française, c'est-à-dire, en somme, une approche de la littérature française en général sous un angle thématique particulier. On peut toutefois remarquer que les études de ce genre, pour la plupart des thèses, vont fournir un corpus non négligeable à la littérature universitaire. Quant à la réflexion sur la naissance de l'exotisme, Roland Lebel apporte peu par rapport à Cario et Régismanset, mais l'ouvrage est intéressant en ce qu'il tente une réelle approche historique du thème exotique. Il apporte surtout une reconnaissance au moins partielle de la littérature de voyage en y incluant des auteurs qui ne sont pas nécessairement des écrivains de profession.
Quant à la littérature coloniale proprement dite, qui fait l'objet de la seconde partie, elle est définie à partir de l'expansion coloniale :
La littérature coloniale est née lentement du succès de nos différentes conquêtes (Georges Lecomte). Elle s'estaffirmée surtout à partir de 1900. On la critiquait naguère à cause du qualificatif dont elle se parait, et sans doute cherchait-on à l'ignorer. Mais à cette heure, la légitimité de son existence n'est plus contestée. Les faits sont là: il existe une littérature coloniale d'expression française" (p. 72).
Lebel distingue trois périodes dans le développement de la littérature coloniale :
la première est celle de l'exploration, "représentée par des récits de voyage, des compte-rendus de mission, des notes de route, des carnets de campagne et des reportages.
la deuxième est celle de la "reconnaissance méthodique et de l'organisation", qui fait l'objet d'une littérature scientifique.
la troisième fait la place à une "littérature touristique et une littérature d'imagination".
On voit que, dans cette perspective, la définition de la littérature coloniale par Lebel est bien plus large que celle de Pujarniscle.
L'exotisme moderne selon Roland Dorgelès